Peindre ou ne pas peindre, telle fut la question pour nombre d’artistes pendant une parenthèse de près de vingt ans à partir des années 1960. Cette problématique est l’occasion d’un ouvrage qui interroge le statut de l’œuvre, de l’artiste et de son positionnement dans l’histoire de l’art.

Éric de Chassey, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art et professeur d’histoire de l’art à l’École normale supérieure de Lyon, assure régulièrement le commissariat d’expositions collectives. Également auteur d’articles, essais, catalogues et livres sur l’art, il vient de publier son dernier livre Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970.
Votre ouvrage aborde une problématique omniprésente dans ces années 1960 et 1970 : la peinture est-elle encore possible ? Pourquoi cette interrogation émerge-t-elle à cette période et dans quel contexte ?
Le premier facteur, le plus important à mon sens, est interne à l’histoire de l’art. La peinture de chevalet apparaît au XIVe-XVe siècle et dès lors commence une histoire téléologique, où chaque artiste est censé faire mieux que celui qui l’a précédé. À partir de Giotto, il y a cette idée de manière moderne. Chaque production artistique s’inscrit au sein d’une histoire de l’art vue comme ayant une évolution linéaire. Or, les avant-gardes du début du XXe siècle marquent une radicalisation de cette idée de progrès, conduisant à une réduction de la peinture à ses spécificités. À force de réduire, on arrive à une sorte de mur correspondant aux années 1960-1970. Il en résulte une remise en cause de ce qu’est l’œuvre d’art en tant que telle et, dans le même temps, de l’art dans le contexte dans lequel il se développe, le système étatique, social. D’individuelle auparavant, cette interrogation devient une tendance généralisée. Et surtout, une problématique qui ne peut plus se régler en restant à l’intérieur de la peinture. On peut parler d’un constat d’épuisement d’une certaine logique.
Vous faites remonter « les premiers derniers tableaux » à Rodtchenko. Pourquoi, si l’on peut dire, ce point de départ de la fin ?
Cette archéologie de la fin de la peinture commence à partir du moment où l’on se trouve dans un processus de réduction. Lorsqu’un certain nombre d’artistes passent à l’abstraction, ils se posent la question de savoir si c’est une solution viable dans la durée. Or ce qui est frappant, c’est de voir que chez les pionniers de l’abstraction, ce n’est qu’un stade vers quelque chose qui n’est que le dépassement de la peinture et de l’art. À partir du productivisme, de Rodtchenko, on a la déclaration explicite du fait que l’on va faire un tableau en sachant que c’est le dernier. Après la Seconde Guerre mondiale, Ad Reinhardt ne dit rien d’autre : je fais le dernier tableau possible.
Comment cette remise en question de la peinture donne-t-elle lieu au développement d’autres formes d’art : l’installation, la performance, l’art conceptuel ?
À la fin des années 1960, nombre d’artistes ressentent ses limites et passent à autre chose. À la suite de l’expressionnisme abstrait états-unien, la tendance qui consiste à penser que l’essentiel se trouve dans l’action de la peinture et non dans le résultat aboutit à considérer le résultat même comme sans importance. C’est ce que l’on voit chez Gutaï, les actionnistes viennois, Carolee Schneemann… Ces artistes déplacent leur intérêt vers d’autres formes et entendent l’art en dehors de la peinture. Entre aussi en considération une forme de protestation contre ce qu’elle représente, l’expression d’une révolte à travers un engagement politique. À la critique de la société s’ajoute le refus du statut marchand de l’œuvre d’art. En effectuant des recherches, j’ai été fasciné par le nombre d’artistes qui se plaignent dans ces années que le monde de l’art a complètement changé, que le marché y joue un rôle majeur et que c’est absolument insupportable.
L’abandon de la peinture serait une réaction face au capitalisme, une tentative d’échapper à la marchandisation de l’art ?
Dans une certaine mesure. On a créé une légende, mais beaucoup d’artistes réalisent très vite que ce n’est pas l’abandon de la peinture qui permet d’éviter le marché. En France, on continue à penser que la peinture est faite pour les bourgeois. Ce qui m’intéressait, c’était de mettre en valeur les artistes, pour lesquels au contraire le tableau était le meilleur moyen de résister. À partir des années 1970, le capitalisme a pris la forme de la vitesse, de l’ubiquité, avec cette idée que l’on peut démultiplier les produits en plusieurs endroits. Or la peinture va à l’encontre, elle incarne la rareté, l’objet unique. D’où le fait que c’est parmi les artistes les plus politisés - par exemple Art and langage en Angleterre - qu’il y a cette revendication du retour à la peinture à la fin des années 1970.
Votre ouvrage est sous-titré « suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970 ». En quoi cette parenthèse a-t-elle changé notre regard ?
La reprise de la peinture pour beaucoup d’artistes correspond au constat que la subversion n’a pas marché. Mais à partir de ce moment-là, la peinture a perdu son statut d’exceptionnalité au sein de la production artistique. Elle n’est plus le modèle absolu, mais un moyen parmi d’autres, d’où la multiplication des artistes multimédias. À partir des années 1980 et 1990, elle est à nouveau présente. Mais chez beaucoup de ceux qui en font, ce n’est pas le seul médium. Tout devient possible. Ce qui a changé de façon très claire, c’est que finit une certaine histoire de l’art linéaire permettant de prédire le pas suivant. L’histoire de la peinture allait avec l’idée qu’il fallait pouvoir l’apprécier, avec raffinement, complexité. Ceci a été en partie disqualifié après cette parenthèse historique, rendant le rapport à la peinture difficile. Être peintre, c’est avant tout s’inscrire dans une histoire, dans le long terme. Aujourd’hui, le rapport à l’histoire est sans direction particulière, on peut aller y chercher ce que l’on veut, choisir de refaire sa propre histoire. Cette période de rupture a également rendu impossible de se penser peintre sans regarder ce qui se passe ailleurs, dans la photographie, l’image numérique… Il est devenu impossible de ne s’intéresser qu’à la seule peinture, dans une autonomie complète.
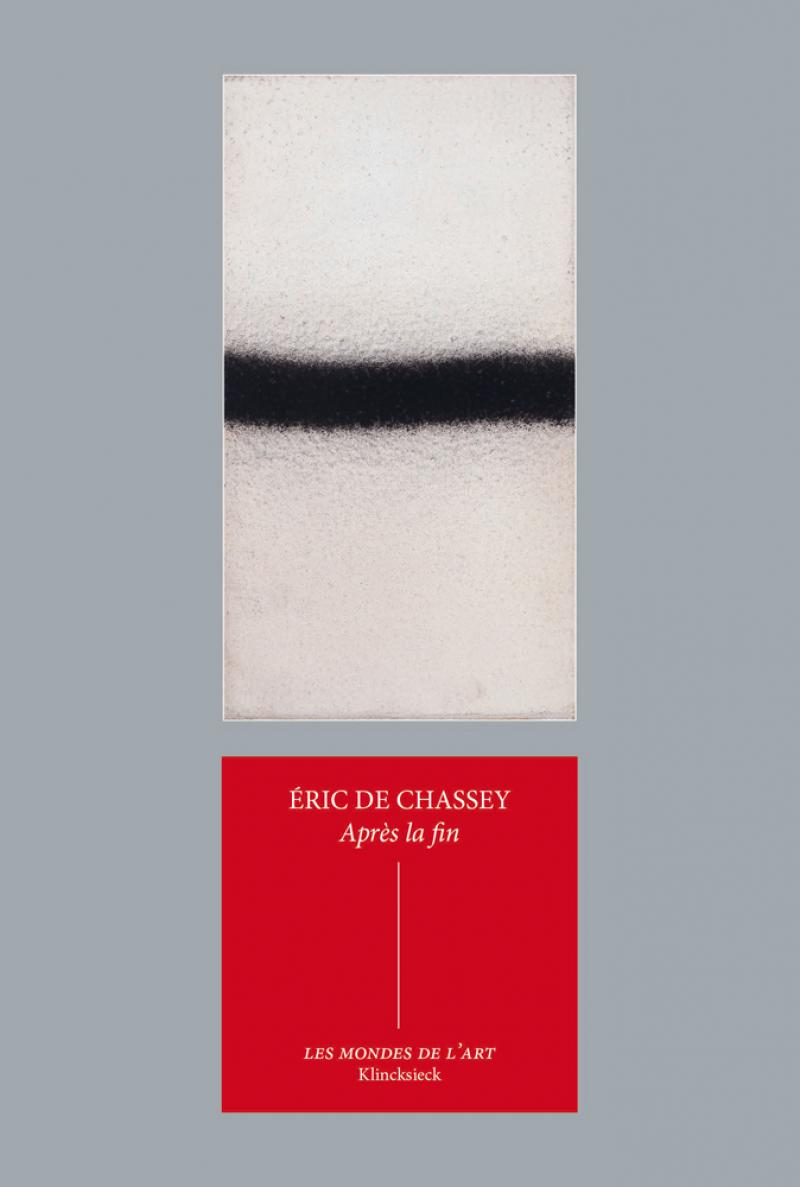
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Éric de Chassey, historien de l’art : « Être peintre, c’est s’inscrire dans une histoire »
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°494 du 2 février 2018, avec le titre suivant : Éric de Chassey, historien de l’art : « Être peintre, c’est s’inscrire dans une histoire »








