Professeur et critique d’art, Achille Bonito Oliva s’est illustré sur la scène de l’art contemporain, à la Biennale de Venise, en créant en 1980 « Aperto », une section consacrée aux jeunes artistes. Chantre de la Trans-avant-garde – un mouvement qu’il théorise dès le début des années 1980 –, il exprime, à l’occasion de la réédition de l’un de ses essais, « L’Art après 2000 », son point de vue sur l’évolution de ce mouvement artistique, sur le renouvellement de génération dont fait l’objet la Biennale de Venise, et sur la politique de la culture.
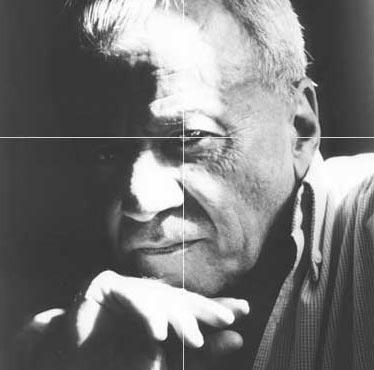
En quoi consiste votre nomination comme conseiller en art moderne et contemporain pour la Région de la Campanie ?
Le président de la Région, Antonio Bassolino, m’a choisi pour être le consultant d’Edoardo Cicelyn, récemment nommé à la tête de la Culture dans cette région. Je vais m’efforcer de donner à Naples les structures et les infrastructures qui lui manquent. Le plus urgent est la création d’un musée d’art contemporain : nous sommes en train d’explorer les lieux d’installation possibles, comme le port, afin de voir comment les équiper assez rapidement pour faire démarrer un vrai musée. Je pense qu’il est possible de bien travailler avec le directeur Nicola Spinosa. En fait, il y a déjà un accord entre la direction générale des Beaux-Arts, le ministère de la Culture et la Région.
Vous avez terminé la mise à jour de votre essai dans l’ouvrage de Giulio Carlo Argan sur l’histoire de l’art moderne, bien connu des étudiants.
Le livre a bénéficié de moyens supplémentaires, dus aussi à l’entrée de Sansoni dans le groupe Rizzoli. Mon essai “L’Art après 2000” englobe les dernières décennies du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’une révision et d’un complément de l’essai qu’Argan m’avait demandé de son vivant. À l’origine, ce n’était qu’un appendice, et il fait maintenant partie intégrante du premier volume, ce qui non seulement flatte mon ego mais montre aussi que le critique a un rôle de premier plan, rôle qui se définit dans ce qu’avait fait Argan précédemment
Dans quel sens ?
L’approche complexe de mon essai est interdisciplinaire et, dans ce sens, j’y reprends la lecture que fait Argan de l’histoire de l’art. Je cherche à contextualiser l’œuvre, à la placer dans son cadre naturel qui est l’Histoire. L’essai commence par les années 1960, à la lumière du dualisme Europe-Amérique, avec deux figures tyranniques : d’une part, Warhol, cette espèce de Raphaël de la société de masse américaine, porteur d’une idéologie du statisme, de la neutralité, de l’objectivité, et d’autre part, Beuys, porteur d’une idéologie de l’art social, ou bien de l’art comme éducation esthétique de la société. Vient ensuite une description des différents mouvements qui se sont succédé : l’art conceptuel, la performance, l’Arte povera, la Trans-avant-garde “chaude” et “froide”, jusqu’aux dernières créations de l’art-communication.
Le livre est également un instrument didactique.
Bien sûr. J’y ai inclus des fiches sur tous les mouvements, en signalant les écrits de référence pour chacun. Il s’agit donc d’un texte qui, je pense, peut concerner un vaste public – cosmopolite et international, ou scolaire.
Quels sont les jeunes Italiens que vous avez décidé de faire “passer à l’Histoire” ?
Parmi les plus connus se trouvent Maurizio Cattelan et Vanessa Beecroft.
Vous interprétez ce processus historique que vous-même avez théorisé, car dans votre essai, il est à nouveau question de la Trans-avant-garde, que vous avez lancée...
C’est un peu l’histoire de l’art qui se débarrasse des limites, un processus qui commence avec Fontana à l’intérieur du tableau, puis continue à l’extérieur avec Pollock et l’Action Painting, circule à travers le Pop’ Art, puis sort du cadre et envahit l’espace avec l’Arte povera. Finalement, on retrouve le plaisir de la narration avec la Trans-avant-garde. Avec le Minimalisme, on avait créé un excès d’abstraction par rapport au social, de même qu’avec l’Arte povera s’est créé un excès d’optimisme et d’énergie, avec lequel on tentait de sortir de l’inertie de la communication. Avec la Trans-avant-garde, ces artistes sont revenus au contenu par la récupération de la subjectivité. Et c’est cela le passage fondamental que je décris dans mon essai : après des décennies pendant lesquelles la valeur de l’œuvre était dans son accomplissement, dans l’autocréation des matériaux, le processus créatif, l’appartenance de l’artiste à un mouvement ou à une tendance politique, la Trans-avant-garde a ramené, d’une façon ou d’une autre, le besoin de formaliser le fait créatif dans une icône, dans une image.
À propos de tendances politiques, comment vivez-vous l’Italie du centre droit ?
Je vis en réaffirmant mon identité d’intellectuel laïc et progressiste, qui vote pour le centre gauche mais qui croit dans l’autonomie de l’art et de la politique, et à qui l’on n’a jamais réussi à imposer des artistes communistes ou socialistes quand il a dirigé la Biennale. En ce moment, le centre droit, à court de manœuvres, semble s’abandonner à un esprit revanchard. Il est disposé, par opportunisme, à s’allier aux forces les plus faibles de ce qui était l’univers progressiste de la culture italienne. Derrière cela, il y a l’intention de punir la culture et les modèles liés à l’avant-garde, à l’expérimentation. En vérité, on pense, de façon démagogique, réparer ainsi les “injustices” du système de l’art, on croit que le centre droit a pour devoir de revaloriser un mouvement qui démarre avec Vespignani et se termine avec des artistes comme Cremonini, et qui, à mon avis, est le déchet d’un réalisme obsolète. Mais la culture du centre droit lui rend hommage comme si elle était la victime du terrorisme de l’avant-garde. Ce même centre droit cherche, stratégiquement, à faire de Balthus une icône gouvernementale, en le comparant aux artistes du XVe siècle : selon moi, Balthus est un artiste glacial, élégant et frigide, un peintre très répétitif et académique, et on voudrait aujourd’hui, en Italie, célébrer les fastes de cette académie. Je pense qu’on ne peut pas imposer un “goût d’État”, basé sur des prédilections personnelles, quand on est en charge du gouvernement.
Avant la nomination de Francesco Bonami, qu’avez-vous pensé de l’idée de placer Robert Hughes à la direction de la Biennale de Venise ?
Si la Biennale cessait de se lier au déroulement des avant-gardes et à l’expérimentation, elle n’aurait plus de public cosmopolite. Venise deviendrait une ville estivale pleine de touristes où l’on aurait créé un public dépourvu d’opinion. Les idées de Hughes sont peu en accord avec la Biennale et elles sont liées à un goût extrêmement provincial de l’art. Et puis, qui est-il ? Il ne fait pas l’opinion. C’est un critique qu’on lit dans le Middle West et à New York.
Vos ennemis disent que vous avez fait du spectacle plus que de la critique...
Je crois avoir fait preuve avec la Trans-avant-garde d’un équilibre entre la critique et la culture que personne n’a pu atteindre. Quand j’ai commencé à théoriser la peinture de ce mouvement, j’ai été accusé de trahir les avant-gardes. Aujourd’hui, tout le monde accepte la Trans-avant-garde, elle est célébrée dans les plus grands musées du monde. L’accusation que vous rapportez ne me touche pas et il y a déjà longtemps que j’ai fait la preuve que ma stratégie était prophétique : ma Biennale de 1993 a été la plus visitée et celle dont on a le plus parlé. Elle est devenue un modèle.
On dit qu’avec l’exposition prévue au Castello de Rivoli, 2002 sera l’année de la Trans-avant-garde.
Selon moi, la décision d’Ida Gianelli, directrice du Castello de Rivoli – et qui est aussi celle du comité scientifique composé de Nick Serota, David Ross et Rudy Fuchs – de réaliser une exposition historique de la Trans-avant-garde, fera de Rivoli – une place forte de l’Arte povera, cet autre mouvement qui a donné un prestige international à l’Italie – un musée authentiquement bipartisan. Ce sera une exposition de stature historique, avec des œuvres allant de 1979 à 1985. Il est également prévu d’acquérir quelques pièces avec des fonds mis à disposition par la Fondation CRT.
L’année 2002 sera aussi celle de la Documenta. Quel type d’exposition peut-on attendre d’un commissaire comme Okwui Enwezor ?
Personnellement, j’en attends peu. Ce que Enwezor va faire, je l’ai déjà réalisé il y a longtemps, au cours de diverses conférences internationales, lorsque j’ai mis en évidence l’importance du social, du dialogue dans les différentes villes. En ce qui concerne l’exposition, elle aura de la force étant donné les grands moyens de la Documenta. Elle sera fondée sur le multiculturalisme, sur la connaissance des cultures minoritaires, sur une extension du système de l’art qui ne peut plus être circonscrit à la dialectique Europe-Amérique. Cela confirme une stratégie d’exposition que j’ai initiée lors de ma Biennale de Venise en 1993, dont le titre – “Les points cardinaux de l’art” – n’était pas dû au hasard.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Achille Bonito Oliva : « Je pense qu’on ne peut pas imposer un goût d’État »
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°147 du 19 avril 2002, avec le titre suivant : Achille Bonito Oliva : « Je pense qu’on ne peut pas imposer un goût d’État »











