À l’occasion de la sortie de son ouvrage de synthèse sur la diplomatie culturelle, l’universitaire en décrit les mécanismes et les limites.

Normalien, agrégé et docteur en histoire, Ludovic Tournès (56 ans) a longtemps enseigné à Rouen puis Paris avant de rejoindre l’université de Genève. Spécialiste du jazz, des fondations américaines et de manière générale des États-Unis, il vient de publier un ouvrage didactique intitulé Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde. Les États entre promotion et propagande (éd. Armand Colin).
Le soft power est un terme de praticien. Si, par exemple, un membre du ministère des Affaires étrangères organise des tournées ou des expositions pour renforcer l’influence de son pays, il dira qu’il fait du soft power. Cependant, en tant qu’historien, je n’emploie jamais ce terme, car il désigne une stratégie d’action et non un concept permettant d’analyser un processus historique. La diplomatie culturelle, en revanche, est un vrai concept historique : elle désigne un répertoire d’actions visant à faire rayonner la culture nationale, mis en œuvre par des acteurs publics et privés – et j’insiste sur ce dernier point. L’Alliance française en est un bon exemple : à l’origine association de droit privé, elle est passée sous la tutelle du Quai d’Orsay après la Première Guerre mondiale.
La diplomatie culturelle et la propagande sont deux choses différentes mais qui se recoupent, rendant la frontière difficile à tracer. La diplomatie culturelle consiste à promouvoir des formes culturelles nationales, tandis que la propagande consiste à instrumentaliser des discours et des objets culturels au service d’un pouvoir politique. Ceci étant, la diplomatie culturelle est elle-même une forme de propagande. La frontière n’existe quasiment plus en période de guerre ou dans les régimes totalitaires. Il faut noter qu’en France les responsables de la diplomatie culturelle utilisaient couramment le terme de « propagande » jusque dans les années 1930, avant qu’il ne soit discrédité.
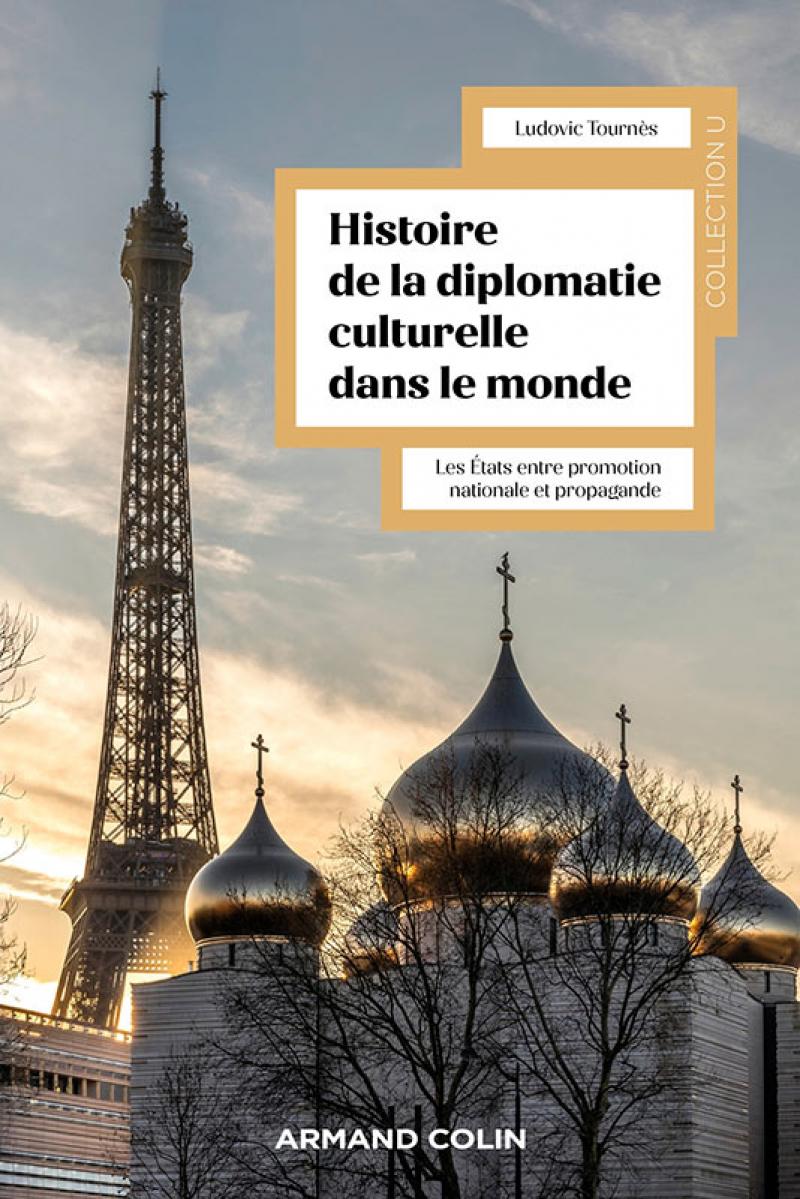
L’émergence de cette pratique est liée à l’émergence des cultures nationales et des États-nations. Dès que ces entités s’affirment et sont conscientes d’elles-mêmes, une diplomatie culturelle se met progressivement en place. Au XIXe siècle, je parle de « proto-diplomatie culturelle ». Elle se caractérise par des acteurs (dont les États) qui n’ont pas encore formalisé une politique cohérente utilisant systématiquement la culture comme moyen diplomatique. Ces acteurs mènent une série d’actions déconnectées les unes des autres. Les missionnaires sont considérés comme des pionniers, car en évangélisant, ils promouvaient leur langue tout en faisant apprendre la Bible. Ils étaient aussi engagés dans la promotion d’un modèle national.
La cristallisation de la diplomatie culturelle en tant que politique cohérente et systématique se produit avec la Première Guerre mondiale. Cette guerre est qualifiée de « totale » (militaire, économique, culturelle, civilisationnelle), et la culture est alors mobilisée comme une arme. À partir de ce moment, les États vont structurer une politique spécifique et cohérente là où il n’y avait auparavant que des initiatives non coordonnées.
La diplomatie culturelle est une partie de la diplomatie : c’est un instrument de pouvoir et une arme diplomatique. Elle sert à faire rayonner un État et à renforcer son influence internationale. L’intérêt principal est géopolitique. Il s’agit de mettre en place une politique de puissance. Les États interagissent sur la scène internationale pour pousser leurs intérêts (économiques, politiques, culturels) et augmenter leur influence le plus possible. La culture est, dans ce contexte, un instrument parmi d’autres.
Je n’adhère pas à l’approche déterministe qui voudrait que l’économie détermine le social, puis le politique, puis le culturel. Sur le terrain, il y a plutôt une interaction très profonde entre ces différents éléments. Cependant, la diplomatie culturelle n’a pas tellement d’autonomie en tant que telle, car elle est complètement liée à la défense d’intérêts politiques et économiques. Les deux vont ensemble. Les stratégies varient selon les États. Les États-Unis, par exemple, ont très tôt mêlé diplomatie culturelle et économique, considérant les produits culturels (comme les films hollywoodiens) d’abord comme des produits économiques.
Ce n’est pas un scoop ! De nombreux travaux montrent que la CIA a mené dès le début de la guerre froide une série d’actions dans le domaine de la culture. Les milieux muséaux (comme le MoMA), la CIA et les grandes fondations (notamment la Rockefeller Foundation) étaient très interpénétrés, la CIA et les fondations finançant le MoMA. Ces expositions visaient notamment à promouvoir l’expressionnisme abstrait. L’idée des promoteurs était que cet art représentait la quintessence du modèle américain : c’était le triomphe de l’individu par opposition au réalisme socialiste soviétique, qui mettait en avant la collectivité. Cet individualisme radical était censé témoigner du « rêve américain ». Ces expositions servaient également à légitimer la culture américaine par rapport à la culture européenne historiquement supérieure.
Il est extrêmement difficile d’évaluer l’impact précis de la diplomatie culturelle. Nous pouvons quantifier le nombre de visiteurs d’une exposition ou d’une tournée, mais il est très compliqué de déterminer si cela se transforme en une vision positive du pays. Mais, oui, il y a des échecs manifestes. Ainsi l’Allemagne de l’Est a investi des sommes énormes dans la formation de ses sportifs, ce qui fut un succès relativement au nombre de médailles. Cependant son image internationale a été totalement ruinée par l’évidence d’un dopage d’État, visible dans la musculature hypertrophiée des nageuses. Le sport, censé glorifier le régime socialiste, a contribué à son discrédit.
Les tournées de musiciens de jazz américains sont un autre exemple d’échec. Le département d’État organisait ces tournées durant la guerre froide pour contrebalancer les accusations de racisme, en montrant des musiciens noirs et des orchestres mixtes. L’idée était de présenter les États-Unis comme une société tolérante, malgré la ségrégation. Or, cette initiative n’a pas réussi à diminuer les accusations de racisme ni la mauvaise image des États-Unis dans beaucoup de pays. Plus récemment, il y a l’exemple des séries télévisées turques en Grèce : la Turquie est la deuxième exportatrice mondiale de séries. Celles-ci sont très populaires en Grèce. Toutefois, l’analyse empirique montre que, si le public grec les apprécie (belles intrigues, beaux acteurs), cela ne se transforme pas en vision positive de la Turquie, en raison du contentieux historique entre les deux pays.
![La série turque « Muhteşem Yüzyıl » [Le Siècle magnifique] a connu un succès mondial depuis sa première diffusion en 2011. © Star TV](/sites/lejournaldesarts/files/styles/libre_w800/public/2025-11/serie-turque-muhtesem-yuzyil-siecle-magnifique-copyright-photo-star-tv.jpg?h=1851c7f5&itok=bgRS2pia)
La Chine a utilisé systématiquement la diplomatie culturelle à partir du milieu des années 2000, la considérant comme un outil de soft power. Le bilan est effectivement mitigé. La Chine a multiplié les actions (Instituts Confucius, promotion de l’Opéra de Pékin, Jeux olympiques), se donnant une visibilité énorme. Cependant, dans les pays occidentaux, la politique de séduction n’a manifestement pas abouti à une amélioration substantielle de son image. Elle n’a pas réussi à contrebalancer les images liées à la répression de Tiananmen [1989] et des Ouïghours, aux pressions sur Taïwan, ni le fait que la Chine est perçue comme un pays totalitaire. En revanche, en termes d’intérêts économiques, il est évident que ces efforts ont facilité ses entreprises. Mais si son image est mauvaise en Occident, elle est probablement bien meilleure en Afrique et en Asie. Pour autant, ces dernières années, un nombre croissant de pays commence à se rendre compte que la politique chinoise de « bon voisinage » peut entraîner un ligotage économique.
C’est une hypothèse sérieuse. Les Instituts Confucius ont été très critiqués et certains ont été fermés, car ils étaient accusés d’être des « nids d’espions », avec semble-t-il quelques raisons. La Chine possède aujourd’hui le plus grand réseau d’instituts culturels au monde. Ce réseau sert également à entretenir un lien avec la diaspora chinoise. Celle-ci est toujours un relais intéressant pour la diplomatie culturelle, car ces nationaux se comportent comme de petits diplomates (voire des espions) qui n’ont pas besoin d’être salariés par l’État.

Oui, nous avons tendance à être obnubilés par notre propre perception. Pendant la guerre froide, la diplomatie culturelle soviétique était extrêmement forte. Les chiffres sont frappants : les programmes d’échange organisés par les États-Unis concernaient des dizaines de milliers de boursiers, tandis que l’URSS en accueillait des centaines de milliers (environ 400 000). Ces étudiants venaient majoritairement des pays du Tiers-Monde et y ont passé plusieurs années d’études supérieures gratuites. Ils ont souvent gardé une meilleure image de l’URSS que de l’impérialisme américain. Ce contexte historique explique sans doute pourquoi tant de pays n’ont pas condamné la guerre en Ukraine.
Depuis la fin de la guerre froide, si la diplomatie culturelle américaine a décliné, la Russie post-soviétique a repris au début des années 2000 une politique ambitieuse, tout comme la Chine. Ces pays cherchent activement à créer un ordre alternatif, et leur diplomatie culturelle s’inscrit dans cette stratégie. Ils bénéficient de la neutralité bienveillante, voire de l’appui, d’un certain nombre de pays du Sud global qui ne sont plus acquis aux Occidentaux et aux États-Unis.
Historiquement, dans la diplomatie culturelle française, les entreprises ont été moins mobilisées qu’elles auraient pu l’être. Par exemple, la politique de diffusion du livre français, bien qu’existante dès la fin du XIXe siècle, n’a pas été très ambitieuse. Il y avait manifestement une grande difficulté à établir la connexion entre la culture et l’industrie de l’édition. Si la France fait évoluer cela depuis une quinzaine d’années, c’est en grande partie sous l’influence d’exemples étrangers, notamment du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud, qui ont bâti leur diplomatie culturelle sur leurs industries culturelles et les ont utilisées comme moyen de rayonnement avec la coordination gouvernementale. Il y a en France une forme de réticence à assumer qu’une stratégie culturelle est en même temps une stratégie économique.
Je n’ai pas d’exemple précis là-dessus. Ce que je peux dire, c’est que la mise en avant de l’État en France est liée à une longue tradition de mécénat étatique pour les artistes, qui remonte à l’époque monarchique. En France, l’État a tendance à « faire la culture ». Ceci contraste avec les États-Unis, où l’État n’avait pas de prérogative culturelle avant le début du XXe siècle, laissant une grande place aux organisations privées. Après la Seconde Guerre mondiale, c’est la synergie entre l’État et les acteurs privés qui fait la force de frappe culturelle inégalée des États-Unis, et l’État soutient beaucoup l’internationalisation de ses artistes.
L’appareil de diplomatie culturelle français est extrêmement important et disproportionné par rapport à la puissance moyenne de la France, qui a le deuxième ou troisième plus grand réseau diplomatique mondial. Mais je ne suis pas sûr que ce réseau coûte si cher que cela. Beaucoup d’établissements, comme le lycée français de New York, sont quasiment de droit privé, font payer très cher leur scolarité et s’autofinancent largement. De même, les Alliances françaises sont des organismes de droit local. En termes d’influence, les lycées français conservent une très bonne réputation à l’étranger, particulièrement auprès des élites. Leur rôle est crucial pour maintenir la langue française, qui, bien qu’en déclin depuis le XIXe siècle, reste la 5e ou 6e langue parlée [selon les sources] dans le monde.
La diplomatie culturelle n’est pas responsable du ratage complet de la diplomatie française en Afrique au cours des soixante dernières années. Le sentiment anti-français dans les anciennes colonies d’Afrique de l’Ouest (bien plus visible que l’« anti-britannisme » dans les anciennes colonies anglaises) révèle un problème lié à la tentative de garder le contrôle, notamment économique, des anciennes colonies. Cet échec politique est catastrophique sur le plan culturel, car l’Afrique est le principal réservoir de locuteurs français.
Oui, cela relativise son rôle. La diplomatie culturelle est subordonnée au politique et elle est une partie de l’arsenal diplomatique qui n’a pas d’autonomie en tant que telle. Cependant, il ne faut pas l’arrêter, d’autant plus qu’elle ne coûte pas très cher. Pour donner un ordre d’idée pour les États-Unis : en 1964, le budget mondial de l’USIA, qui coordonnait la diplomatie culturelle, équivalait au coût d’un seul sous-marin.
Il est difficile de répondre, car l’invisibilité de l’État est souvent un atout pour l’image. Dans de nombreux cas (séries turques, K-pop, mangas japonais), le public ne voit pas que l’État est derrière. Par exemple, l’exportation de la K-pop ou des mangas n’est pas vue comme une action de diplomatie culturelle japonaise ou coréenne, sauf si l’on creuse le sujet. Paradoxalement, le fait que cela ne soit pas vu comme une action de l’État renforce le côté positif de l’image (le Japon et la Corée sont perçus comme « cool »). Cependant, l’État est bien là, à des degrés divers, et cherche à obtenir des gains économiques.
Le numérique est un « game changer » dans la diplomatie publique et la propagande. On voit à quel point les réseaux sociaux sont un instrument d’information et surtout de désinformation énorme. En diplomatie culturelle, si le numérique est clairement un outil (on utilise beaucoup les réseaux sociaux), il n’a pas complètement changé les règles du jeu comme il l’a fait pour la propagande.
Je ne crois pas au « soft power » tout seul. Il va toujours avec le « hard ». En revanche, le « hard » peut se passer du « soft », ce que démontre l’administration Trump. Celle-ci n’investit pas dans la diplomatie culturelle, qu’elle considère comme un gaspillage d’argent public, et ne croit qu’au rapport de force, qui permet d’obtenir des résultats à court terme, mais au prix d’une détérioration considérable de l’image des États-Unis qui finira par leur poser des problèmes. Non seulement parce qu’un anti-américanisme structurel s’enkyste dans beaucoup de pays, mais aussi parce que cela va décourager l’émigration aux États-Unis d’étudiants et de chercheurs. Or, le système d’enseignement et de recherche américain n’est pas capable de produire suffisamment de cerveaux pour alimenter son économie et sa recherche. 40 % des doctorats soutenus aux États-Unis le sont par des étudiants étrangers.
Si la mauvaise image et les tracasseries administratives (comme l’interruption des processus de candidature ou la menace d’expulsion des étudiants) entraînent une baisse de 15 à 20 % du nombre d’étudiants étrangers, cela pourrait gripper la machine économique et de recherche. De grandes universités comme Columbia, Harvard et le MIT ont énormément d’étudiants étrangers, et une baisse pourrait les obliger à fermer des départements.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Ludovic Tournès : « La diplomatie culturelle est subordonnée au politique »
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°665 du 14 novembre 2025, avec le titre suivant : Ludovic Tournès : « La diplomatie culturelle est subordonnée au politique »









