En hommage à Rochlitz Le séminaire « Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes », qui s’est tenu en 2002 et 2003, fait l’objet d’une publication.
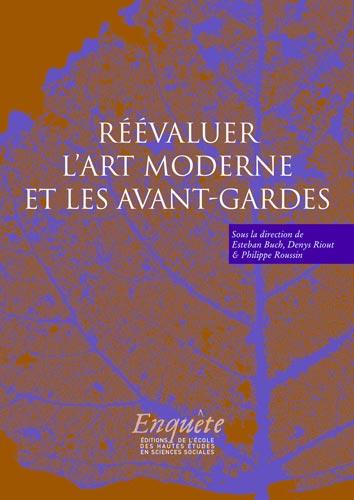
En 2002, le philosophe Rainer Rochlitz (1946-2002) disparaissait au cours du séminaire qu’il dirigeait à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris, sous le titre programmatique « Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes ». L’EHESS prolonge aujourd’hui le travail de Rochlitz dans un ouvrage au titre éponyme, introduit par la retranscription du manuscrit de la dernière communication du philosophe, témoignage précieux des dernières étapes de son travail.
Réévaluer pour mieux comprendre
Ce séminaire s’inscrit dans l’après-coup d’une pensée de la postmodernité qui, en proclamant la « fin des grands récits » (Jean-François Lyotard) dans un contexte politique redessiné par la chute du mur de Berlin, déclarait révolue l’ère moderne – dont les modèles furent du même coup violemment rejetés par les artistes et la critique. Observateur concerné de « la querelle de l’art contemporain » qui s’ensuivit en France, Rainer Rochlitz s’était attaché à sonder, dans son projet esthétique, les paradigmes de l’art dont on avait déclaré la fin, et où dès lors la subversion était institutionnalisée (Subversion et subvention, publié en 1994). Dans ce contexte, et alors que s’observe dans l’art le plus contemporain une forte tendance à la référence aux avant-gardes, voire à de nouvelles revendications de paternité dans la perspective d’un art qui recouvrerait une valeur d’usage dans la société, il convenait de s’atteler à une telle « réévaluation » pour comprendre l’intérêt de ces œuvres et leur héritage chez leurs contemporains.
« L’histoire de l’art moderne ne devrait-elle pas être à même de rendre compte de la place et de la force des œuvres sans entériner les discours qui les ont entourées et souvent encensées, et sans les rejeter du fait d’un désaccord avec ces discours ? » Tel fut énoncé le projet de ce séminaire, qui, en substance – et c’est une manifestation plutôt surprenante d’humilité de la part des critiques d’art – désigne les apories de l’hypertrophie textuelle et théorique qui a pu encombrer la perception de l’art, en particulier depuis les années 1960… « Savons-nous seulement ce que nous devons à ces œuvres ? », questionne Rainer Rochlitz dans son ultime conférence sous le titre « Art moderne et société moderne » où, en mettant à l’écart les supposés théoriques auxquels elles ont été assimilées, le plus souvent a posteriori, il propose de réexaminer l’apport des œuvres de l’art moderne sous un angle sociologique. Il s’agit d’établir un lien entre l’histoire de la démocratisation des sociétés occidentales et l’apparition des avant-gardes, en s’intéressant de plus près à l’impact de la réception des œuvres sur le collectif et l’individu : « S’il n’y avait pas eu les arts modernes et les avant-gardes […], peut-on dire en quoi les sociétés modernisées, les sociétés actuelles seraient différentes et en quoi nous serions des personnes différentes ? »
S’affranchir des théories postmodernes
En aval de cette hypothèse sociologique qu’il appartiendra aux disciples de Rochlitz d’approfondir, le séminaire, qui compte onze allocutions, se prêtait à une étude d’ordre historiographique (et pluridisciplinaire) susceptible de dissoudre les cristallisations théoriques dues à de mauvaises interprétations des textes fondateurs ainsi que de nombreux amalgames à la peau dure. Tout à fait éclairante est à ce titre l’intervention de Georges Roque « Abstraction et modernisme », où l’auteur interroge à nouveaux frais les rapports entre deux termes associés à tort et dont le premier a été longtemps condamné par la critique en conséquence du discrédit jeté sur le deuxième. En effet, l’art abstrait a souvent été désigné comme l’emblème d’un modernisme défini en opposition à l’avant-garde révolutionnaire engagée dans la transformation de la société. L’abstraction, dont le théoricien américain Clement Greenberg est perçu comme le défenseur invétéré, serait dans ce sens la forme symptomatique d’une pensée de l’art pour l’art détaché de toute préoccupation politique. La démonstration de Georges Roque dément doublement cette idée reçue en rappelant d’abord l’intérêt de Greenberg pour l’art figuratif et sa condamnation de certaines œuvres abstraites, comme celles du Kandinsky après 1917. Cette mauvaise interprétation tiendrait en partie à l’ambiguïté du terme « abstractness » traduit par « abstraction » alors qu’il désigne plus précisément la dynamique de couleurs et de formes qui se jouent sur la surface de la toile au premier plan du sujet. L’auteur du pamphlet contre la manipulation des masses par l’esthétique officielle des totalitarismes, Avant-garde et kitsch, n’a en outre jamais affirmé la supériorité de l’abstrait sur le figuratif. « Bref, ses raisons sont d’ordre historique et non pas ontologique », insiste Georges Roque, rappelant que l’art pour l’art était en ce sens éminemment politique.
Sous la direction d’Esteban Buch, Denys Riout et Philippe Roussin, Réévaluer l'art moderne et les avant-gardes, éditions de l’EHESS, 2010, 244 p., 22 €, ISBN 978-2-7132-2277-1
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Esteban Buch, Denys Riout et Philippe Roussin - Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°349 du 10 juin 2011, avec le titre suivant : Esteban Buch, Denys Riout et Philippe Roussin - <em>Réévaluer l’art moderne et les avant-gardes</em>








